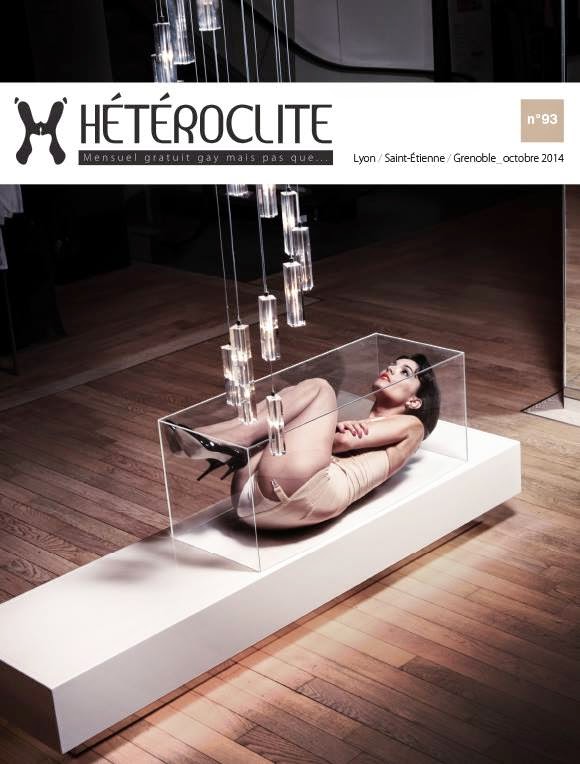Pour ma seconde participation en tant que chroniqueur à l'émission Homomicro sur Fréquence Paris Plurielle (106.3 FM), j'ai choisi de parler de la sortie en DVD du très exceptionnel documentaire Word is out : histoires de nos vies (éd. Films du Paradoxe). Réalisé en 1977, ce film extraordinaire donne la parole à 26 gays et lesbiennes qui racontent leur vie de façon poignante. Le choix de ce film collait parfaitement au reste de cette émission tout à fait passionnante puisque Brahim Naït-Balk, son animateur, l'avait construite autour de la question de la mémoire…
Le podcast est en ligne ici :
http://www.homomicro.net/wp/#.VGWZ9vSG_KM
jeudi 13 novembre 2014
Avec Arielle Dombasle aux Mots à la Bouche
J'ai eu le plaisir d'animer, mercredi 12 novembre, la rencontre avec Arielle Dombasle organisée à la librairie parisienne Les Mots à la Bouche pour la sortie du DVD de son film Opium (Epicentre éditions). Drôle, belle, vive, brillante et délicieusement sympathique, Arielle Dombasle s'est prêtée au jeu des questions-réponses durant une heure, évoquant son lien particulier avec l'homosexualité, sa passion pour Jean Cocteau et son œuvre, son propre statut "d'héritière terrible" du poète, la construction très libre d'Opium autour de la relation Cocteau-Raymond Radiguet, etc. Un public nombreux et très intéressé était venu pour ce moment très agréable et réussi.
Merci à Epicentre de m'avoir proposé ce rendez-vous, et à l'équipe des Mots à Bouche de nous avoir accueillis. Merci aussi bien sûr et surtout à Arielle Dombasle pour sa gentillesse et sa disponibilité. (Et un grand merci à Jérôme Cousin pour les photos souvenir !).
dimanche 2 novembre 2014
Ce qui transgresse, chronique pour Hétéroclite
Bruce LaBruce, la dixième édition de Face à Face à Saint-Etienne… J'ai beaucoup écrit dans le nouveau numéro d'Hétéroclite (http://www.heteroclite.org/), en plus bien sûr de ma chronique culturelle mensuelle, Feux croisés. En voici donc la livraison de novembre, Ce qui transgresse, où il est question d'Alain Guiraudie et de Gregg Araki…
Il n’y a que deux choix dans la vie : se conformer ou transgresser. Être celui que les autres voudraient qu’on soit ou être soi à ses risques et périls. Le désir, la sexualité, le sexe, la baise nous poussent ici ou là, révélateurs intimes tant de nos gouffres que de nos aspirations. Parce qu’il a trop voulu se nier, le père de l’héroïne du beau et très hiératique dernier film de l’ex-trublion Araki, White Bird, va se noyer. On n’en aurait rien su, cela serait resté caché, masqué, sans l’appel du cul, la pulsion des corps, l’image fugace d’un corps-à-corps inattendu qui fait tout basculer.White Bird est ainsi un grand film de l’interdit, du refoulé, de l’oppression acceptée et de l’impossibilité d’en sortir, sauf à exploser en vol. Tout le contraire de ce que raconte Alain Guiraudie dans son premier et réjouissant roman, récit de la frénésie sexuelle et du passage à l’acte assumé de tous les fantasmes, même les plus dérangeants (gérontophilie, fétichisme et scatologie notamment).
Alors que chez Araki il faut attendre les derniers plans pour que tout se révèle, tout est déjà affirmé dès les premières pages d’Ici commence la nuit, lorsque Gilles, le narrateur, chipe un slip kangourou à un nonagénaire, l’enfile et se met à bander aussi sec… Et ce n’est que le début de ce texte décoiffant, où les barrages des normes (sociales ou sexuelles) n’existent pas, où les mots font exulter les corps en toute trivialité. C’est bon, il faut le dire, cette impudeur jetée à la face du lecteur dans une langue familière et inventive. On y retrouve nombre de motifs de l’œuvre cinématographique de Guiraudie, même si le livre, très direct, est très différent des films qu’il évoque :L’Inconnu du lac ici, Le Roi de l’évasion là, Ce vieux rêve qui bouge ailleurs… Chez Araki, l’auto-répression et la violence qu’elle engendre empêchent toute possibilité de bonheur. Chez Guiraudie, en dépit de la violence, de la douleur, de la mort qui rôde, cette acceptation totale de soi conduit le roman à s’achever (ou quasi) avec les mots «bonheur» et «heureux»…
White Bird de Gregg Araki.
Ici commence la nuit d’Alain Guiraudie, éd. P.OL.
Il n’y a que deux choix dans la vie : se conformer ou transgresser. Être celui que les autres voudraient qu’on soit ou être soi à ses risques et périls. Le désir, la sexualité, le sexe, la baise nous poussent ici ou là, révélateurs intimes tant de nos gouffres que de nos aspirations. Parce qu’il a trop voulu se nier, le père de l’héroïne du beau et très hiératique dernier film de l’ex-trublion Araki, White Bird, va se noyer. On n’en aurait rien su, cela serait resté caché, masqué, sans l’appel du cul, la pulsion des corps, l’image fugace d’un corps-à-corps inattendu qui fait tout basculer.White Bird est ainsi un grand film de l’interdit, du refoulé, de l’oppression acceptée et de l’impossibilité d’en sortir, sauf à exploser en vol. Tout le contraire de ce que raconte Alain Guiraudie dans son premier et réjouissant roman, récit de la frénésie sexuelle et du passage à l’acte assumé de tous les fantasmes, même les plus dérangeants (gérontophilie, fétichisme et scatologie notamment).
Alors que chez Araki il faut attendre les derniers plans pour que tout se révèle, tout est déjà affirmé dès les premières pages d’Ici commence la nuit, lorsque Gilles, le narrateur, chipe un slip kangourou à un nonagénaire, l’enfile et se met à bander aussi sec… Et ce n’est que le début de ce texte décoiffant, où les barrages des normes (sociales ou sexuelles) n’existent pas, où les mots font exulter les corps en toute trivialité. C’est bon, il faut le dire, cette impudeur jetée à la face du lecteur dans une langue familière et inventive. On y retrouve nombre de motifs de l’œuvre cinématographique de Guiraudie, même si le livre, très direct, est très différent des films qu’il évoque :L’Inconnu du lac ici, Le Roi de l’évasion là, Ce vieux rêve qui bouge ailleurs… Chez Araki, l’auto-répression et la violence qu’elle engendre empêchent toute possibilité de bonheur. Chez Guiraudie, en dépit de la violence, de la douleur, de la mort qui rôde, cette acceptation totale de soi conduit le roman à s’achever (ou quasi) avec les mots «bonheur» et «heureux»…
White Bird de Gregg Araki.
Ici commence la nuit d’Alain Guiraudie, éd. P.OL.
jeudi 30 octobre 2014
Podcast de l'émission Homomicro du 27/10
 Lundi 27 octobre, j'ai pu renouer avec mon passé radiophonique, en rejoignant l'équipe de chroniqueurs de Homomicro, l'émission animée chaque semaine par Brahim Naït-Balk sur Fréquence Paris Plurielles. J'y parlerai cinéma et DVD une fois tous les quinze jours. Pour la première, je suis revenu sur Bande de filles, le beau film de Céline Sciamma.
Lundi 27 octobre, j'ai pu renouer avec mon passé radiophonique, en rejoignant l'équipe de chroniqueurs de Homomicro, l'émission animée chaque semaine par Brahim Naït-Balk sur Fréquence Paris Plurielles. J'y parlerai cinéma et DVD une fois tous les quinze jours. Pour la première, je suis revenu sur Bande de filles, le beau film de Céline Sciamma. Le podcast est en ligne ici : http://www.homomicro.net/wp/#.VFIHfIuG_KN

vendredi 10 octobre 2014
La lucidité au Salon d'automne, du 16 au 19 octobre
J'ai entamé il y a plusieurs mois avec Pascale Morelot-Palu un travail autour de différentes notions, dont la première est la lucidité, en tentant de mettre en résonance ses peintures et mes textes. Nous nous sommes arrêtés sur ce premier thème en nous rendant compte de l'importance pour elle et moi de la phrase sublime de René Char : "La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil." Invitée au Salon d'automne (du 16 au 19 octobre sur les Champs-Elysées), Pascale a choisi d'y exposer le premier diptyque de cet ensemble en cours d'élaboration, et bien sûr, puisque c'est un diptyque, les deux textes correspondants. Les voici, en attendant la suite…
Lucidité 1 : le fils
Il y avait la voix de mon père.
Il y avait les mots de mon père.
Il y avait le ton de la voix et des mots de
mon père.
Là. Derrière moi. L'ombre de mon père. A me
toucher.
J'entendais ces mots. J'entendais cette
voix. Et les conseils qu'ils portaient.
Et lui, et son souffle si proche, et l'air
brassé par ses ailes.
Et ses efforts pour rester à portée de moi.
Mais je ne me retournais pas.
Il y avait le génie de mon père. Et il y
avait la prudence de mon père. Je n'avais pas l'un et je ne voulais pas avoir
l'autre.
Comme j'avançais !
Oh, comme j'avançais !
Comme je montais. Plus haut. Plus haut.
Plus haut. Plus haut.
Peu à peu il n'y a plus eu que le murmure
assourdi de la voix de mon père, le bruissement indistinct des mots de mon
père.
Loin. Derrière moi.
Je ne me suis pas retourné.
J'ai jeté un œil juste en dessous de moi,
et j'ai vu les côtes de l'île, et le fracas blanc des vagues sur les rochers,
et la terre aride, et j'ai vu le Labyrinthe, l'œuvre du génie de mon père, mais
si lointain, si petit, si dérisoire, que j'en oubliais presque combien cela
avait été difficile de le fuir.
Et j'ai senti, là, dans mon dos, la puissance
de mes ailes qui me poussaient en avant, en hauteur, plus en avant, plus en
hauteur, le génie propre de ces ailes inventées par mon père qui m'éloignait à
chaque battement un peu plus de la prison qu'il avait édifiée et dont il nous
avait délivrés.
Je ne saurai jamais créer cela, ni les
ailes ni le Labyrinthe, mais je saurai m'élever bien au-dessus de mon père. Ce
sera cela mon génie propre. Aller où il ne pourra jamais aller, où il n'aura
jamais même rêvé d'aller, ou dont il aura eu peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai
jamais connu la peur. Ni de l'inconnu ni du Minotaure. Ni des géants ni des
rois. Et pas plus des fils de Dieux ou des sortilèges.
J'irai où ils n'iront jamais. J'y vais. J'y
vole. Vers le ciel infini de la Crête et du monde, vers l'azur qui reflète les
mers, vers les étoiles qui colonisent la nuit, vers le soleil enfin où je
défierai Hélios et Apollon de mon éclat.
Oui. Je serai l'égal des Dieux dans ces
hauteurs de l'univers. Je dépasserai l'Olympe.
Comme j'avance.
Oh, comme j'avance !
Oui. Je toucherai le soleil et j'éblouirai
mon père.
Il ne doit plus être qu'une tache, là-bas,
juste au-dessus de l'eau, juste un point noir qui admire son fils dans sa
course vers le soleil, qui a compris peut-être que mon exploit éclipsera sa
gloire.
Je ne me retourne pas.
Il n'y a plus d'ombre pour moi. Il n'y a
plus son ombre qui pèse sur moi. Il n'y a plus d'ombre pour me protéger de la
chaleur et de la lumière. Il n'y a plus que l'air remué par mes ailes pour un
instant me rafraîchir.
Oh oui. Je suis si près. Si près. Je sens
la beauté et la violence du soleil juste au bout de mes doigts. Je sens le feu
du soleil qui gagne mes ailes. Je sens que je suis près de mon but, que je
brûle.
Le soleil me dévore.
Je le laisse faire. Je fais corps avec lui.
Je lui appartiens.
Je brûle. Je suis une torche, un nouveau
soleil qui fonce vers la terre et la mer, et la Grèce, et la Crête, et la
Sicile, pour les illuminer bientôt.
Lucidité 2 : le père
J'ai su, j'ai toujours su, quand il était
tout petit déjà, il était pareil, déjà, et j'ai toujours su que je n'y pourrais
rien. Qu'est-ce que j'aurais pu faire ? J'ai fait ce que j'ai pu.
J'ai eu des torts bien sûr, et j'ai commis
des crimes qui me poursuivent encore : l'a-t-il appris ? J'ai précipité un
homme dans le vide parce qu'il m'avait volé une invention. Je me suis mis au
service d'un tyran. J'ai aidé une femme, sa reine, à accoucher d'un monstre et
j'ai mis ce monstre en cage dans une prison sans issue. Et je me suis laissé
enfermer avec lui. Comme une punition. Et mon fils, mon fils, aurais-je dû le
laisser dehors, aurais-je dû le laisser à sa mère, à la merci du roi et de sa
colère ? Je l'ai pris avec moi et, dans notre solitude, je lui ai tout
enseigné. Toutes les sciences que je connais, celle du vent et des voiles,
celle de la mer et des bateaux, celle des outils et de la matière que l'on
sculpte ou que l'on taille, celle aussi de l'architecture qui m'a fait
concevoir le Labyrinthe et ses secrets.
Combien de temps avons-nous erré dans ces
couloirs hantés par le monstre, moi lui enseignant, le tenant par la main, et
lui si désireux de s'affranchir, de courir au devant du danger, au devant du monde,
de la vie ou de la mort ? J'ai oublié. Je ne l'ai pas vu grandir. [Mon fils,
mon enfant.]
Il étouffait bien sûr, dans ce monde confiné.
Il étouffait de mon savoir. Il voulait façonner sa vie, conquérir l'univers et
ses mystères. Il voulait se frotter aux autres, se battre avec le destin, il se
rêvait un avenir de héros comme tous les enfants. Et surtout il voulait partir,
bien sûr, sortir de ce triste palais façonné de mes mains. Tout le monde
l'aurait voulu. Et moi ? Je ne sais pas. Je n'y pensais pas. Je n'y ai pensé
que pour lui.
Et j'ai eu peur en y pensant. Car je savais
qu'il m'échapperait alors en échappant à ce lieu clos. Qu'il voudrait voir et appréhender
le monde par lui-même et ne plus m'écouter. Qu'il allait, à peine sorti,
m'abandonner, me laisser-là avec mes remords et mes ambitions. Mais
qu'aurais-je pu y faire ? C'est la vie, n'est-ce pas ?
J'ai forgé l'objet de notre évasion, ces
grandes ailes de bois, de toile, de colle et de plumes. J'ai revêtu les miennes
et je lui ai expliqué comment on s'en servait, comment glisser sous le vent,
utiliser les courants ascentionnels grâce auxquels nous dépasserions les hauts
murs dépourvus de toit du Labyrinthe, et ceux qui nous mèneraient vers la mer. Je
voulais l'attacher à moi et le porter vers cette liberté dont il rêvait tant
mais il a protesté. Il a dit qu'il n'était plus un enfant que l'on porte, qu'il
volerait de ses propres ailes. Je l'ai regardé. Et j'ai vu ce que je n'avais
pas vu depuis tout ce temps, combien de temps ?, qu'il était un homme
désormais. Un jeune homme beau, fier et arrogant comme je l'avais été. Ô comme
il me ressemblait, et cela aussi me faisait frémir.
Il ne souriait pas quand il a dit "Je
volerai seul vers mon destin". Et j'ai su, et je me suis souvenu que
j'avais toujours su mais que j'avais oublié.
J'ai dessiné ses ailes, je les ai ajustées
pour qu'elles soient idéalement à sa taille, j'ai répété mes conseils sur le
vent et les courants et je lui ai dit "Tu resteras derrière moi."
Mais j'ai vu dans son regard qu'il ne le ferait pas. Qu'est-ce que j'aurais dû
faire ?
Il n'était pas midi quand nous avons pris
notre envol. Au début, il m'a suivi. Peut-être à ce moment-là m'admirait-il
encore ? Mais cela n'a pas duré longtemps. Il s'est laissé griser par tout cet
air, par tout cet espace qui s'ouvrait devant lui, par toutes ces possibilités
qui s'offraient à lui désormais. Il m'a dépassé. Il volait au rythme propre de
ses propres ailes et n'en faisait qu'à sa tête. Il tournoyait dans le ciel. Il
filait droit devant lui en riant. Il criait au soleil qu'il arrivait. Il
défiait les Dieux, et les oiseaux, et les cieux. Il montait et ne m'écoutait
pas, ou ne m'entendait pas, qui sait ? Et qu'importe. Il ignorait les risques
et mes avertissements. Qu'est-ce que j'aurais pu faire ?
Je l'ai vu s'éloigner. Je l'ai vu se
dissoudre dans l'immensité. Il n'était plus qu'une tache infime devant l'astre
jaune à son firmament.
Et puis j'ai entendu un cri dans l'azur et
j'ai vu une torche qui tombait dans la Méditerranée, une torche folle et
hurlante illuminant la terre et la mer, et la Grèce, et la Crête, et la Sicile.
Après, un grand silence.
J'étais seul au-dessus de la mer. Je ne
pouvais plus bouger. Je me suis laissé porter sur les ailes du vent et j'ai
atterri ici sans savoir comment. J'y suis bien, j'y soigne ma douleur. Je pense
que je n'en partirai plus.
Souvent, tous les jours sûrement mais je ne
tiens pas les comptes, je pense à mon fils et à sa vie trop courte d'insolent
météore.
Je me dis que ce fut un accident. Je me dis
que j'ai fait son malheur. Je me dis que je l'ai trop protégé et qu'il n'était
pas prêt à affronter le monde. Je me dis que je ne l'ai pas assez protégé. Je
me dis que les Dieux me font payer mes fautes. Mais je me dis aussi que je
savais que cela arriverait, ainsi ou autrement, que je l'ai toujours su. Et je
ne vois pas ce que j'aurais pu y faire.
J'ai la mémoire qui flanche…, ma chronique pour Hétéroclite
Ma dernière chronique Feux croisés pour le magazine Hétéroclite, autour du fabuleux documentaire Portrait of Jason et du roman policier Le Bal des hommes.
Mais comment vivait-on ? On oublie vite, on a déjà oublié. Or cette question en porte une autre en elle, plus importante encore peut-être : comment en est-on arrivé là ? Là, c’est-à-dire aujourd’hui, à nos vies, à nos modes de vie, à nos droits, à nos revendications. On en crève, on se dessèche d’évacuer ce passé, de ne pas le regarder, de faire comme si tout était toujours allé de soi, de penser qu’hier était comme aujourd’hui et que demain dès lors sera pareil. Car, bien sûr, on ne vivait pas ainsi il y a quelques décennies : il a fallu tout conquérir pour surmonter les oppressions, il a fallu s’affirmer, il a fallu être courageux, il a fallu être folle souvent. Car oui, notre histoire bien souvent a été forgée par les folles, n’en déplaise à tous ceux qui pensent que c’est en se cachant qu’on fait bouger les choses. Comment vivait-on, pédé et black, dans l’Amérique des années soixante, alors que le mouvement gay émergeaient à peine ? Le génial documentaire de Shirley Clarke Portrait of Jason, tourné en 1967, en offre un aperçu en laissant la parole à ce personnage hors-norme qu’est Jason. Prostitué et artiste de cabaret, il raconte sa vie réelle et sa vie inventée, entre vérité et mythomanie, qui nous révèle ainsi un certain moment de l’Amérique homosexuelle. Longtemps inédit en France, ce grand film au dispositif narratif stupéfiant vient de sortir en DVD. Autres temps, autres mœurs, autre approche dans le savoureux Bal des hommes : celle de la pure fiction, policière qui plus est, pour approcher les milieux homos parisiens des années 30. Derrière l’intrigue à tiroirs dont l’amusant point de départ est la mort d’un tigre du zoo de Vincennes à qui on a coupé le sexe pour le réduire en poudre aphrodisiaque, Gonzague Tosseri (un nom de plume utilisé par deux journalistes unis pour ce roman) raconte de façon très documentée la sexualité, les rencontres, la pression policière, les arrière-cours du désir et de la vie quotidienne chaotique de ceux qu’on appelait alors les invertis. Deux utiles, très utiles rappels…
Portrait of Jason de Shirley Clarke (en DVD aux éditions Potemkine)
Le Bal des hommes de Gonzague Tosseri (éditions Robert Laffont)
mardi 2 septembre 2014
Des traces de nous, chronique pour Hétéroclite
Livraison de rentrée du magazine Hétéroclite, avec le nouveau volet de ma chronique culturelle mensuelle, Feux croisés, intitulée ce mois-ci Des traces de nous…
Il y a ceux dont on sait tant de choses, dont tant d’éclats nous ont éclaboussés de leur vivant et nous parviennent encore après leur mort. Ceux qui nous appartiennent à tous tant ils ne s’appartiennent plus à eux-mêmes. Ceux que l’on s’est tous, un peu (et les artistes plus que d’autres) appropriés. Et puis, il y a ceux dont on sait si peu, dont les fantômes ne hantent que ceux, infiniment rares, qui les ont croisés ; et d’autant plus que leurs traces sont diffuses, presque effacées. C’est la différence entre une star et un anonyme, entre une image iconique et une image manquante, entre Saint Laurent tel que fantasmé désormais par le cinéma (le film de Bertrand Bonello après celui de Jalil Lespert), et le père absent, desaparecido comme elle dit, de Samantha Barendson, qui construit autour de cette figure sans contours un texte aussi court que saisissant, Le Citronnier. Entre Saint Laurent, belle et brillante réinvention du mythe du grand couturier, de sa relation avec Pierre Bergé, de ses folles années 70, de ses pulsions sexuelles, et le Francisco Barendson du Citronnier, disparu alors que sa fille n’avait que deux ans et qui ne lui a laissé que six photos, un tableau du chat du Cheshire et douze verres colorés, il y a un gouffre. Celui entre le trop-plein d’une vie ultra-exposée et le vide d’une vie secrète, car il n’y a même pas de souvenirs chez Samantha Barendson : que des vides qu’elle cherche à combler au fil des pages, à coup de questions, de réminiscences vagues, de recherches, de rêveries. Bonello fantasme Saint Laurent et projette sur lui ses interrogations permanentes (sur l’identité, la mémoire, l’histoire…). Barendson, elle aussi, à sa manière, fantasme son père jusqu’au moment où une réponse, inattendue, alors qu’elle croyait être dans une impasse, la renvoie vers d’autres interrogations : sur l’identité, l’histoire, la mémoire. Le film de Bonello est superbe parce qu’il touche, via sa recréation du personnage Yves Saint Laurent, à l’universel. Le livre de Samantha Barendson est magnifique parce qu’il touche à l’intime le plus absolu. Autant dire, parce que ce sont deux œuvres infiniment personnelles, qu’ils parlent de la même chose : de nous, de nos traces, de nos héritages.
Saint Laurent de Bertrand Bonello. Sortie le 24 septembre
Le Citronnier de Samantha Barendson, éditions Le Pédalo ivre, 10 €.
Le Citronnier de Samantha Barendson, éditions Le Pédalo ivre, 10 €.
jeudi 14 août 2014
Exposition Murs-Murs, de Pascale Morelot-Palu
Peintre dont j'admire le travail, architecte brillante et reconnue, mon amie Pascale Morelot-Palu m'a demandé d'écrire un texte pour le catalogue de sa nouvelle exposition à Lyon, en septembre prochain, à la Galerie Burdeau. J'ai bien sûr accepté avec enthousiasme. Le voici en attendant de découvrir ses œuvres…
Pascale Morelot-Palu a intitulé Un
souffle de mur sa dernière série, puisque c'est ainsi qu'elle fonctionne,
par séries qui s'étendent et se déploient dans le temps et l'espace, qui se
complètent dans leur dispositif et se déclinent dans leurs motifs, à
l'intérieur de chacune et entre elles toutes.
Un souffle de mur donc, après Les
Murs révélés et Les Murs sauvages,
autant dire une appropriation moins physique, moins concrète, moins inscrite
dans la matière de ces fameux murs autour desquels, artiste ou architecte, elle
ne cesse de tourner, de se cogner, de se retourner pour en explorer toutes les
acceptions, psychologiques et organiques, historiques et mythologiques. Elle
dit elle-même qu'il s'agit là, dans son projet et sa technique de récupération
pour cette nouvelle série de surplus de peinture gratés sur d'autres tableaux,
de donner corps à une "idée de mur"
; et l'on entend comme en écho à cette "idée de mur", à ce
"souffle de mur", le titre polysémique et ludique d'un beau
documentaire d'Agnès Varda sur l'art des graffeurs et autres street artists de
Los Angeles, Mur Murs. Autant dire,
concernant ce qu'entreprend Pascale Morelot-Palu avec cette nouvelle variation
sur ce même thème qui est le cœur battant de son œuvre et de sa réflexion, que
l'on peut aussi sans mal lire "Murmures".
Car voilà ce qui se joue ici fondamentalement, dans le contraste
saisissant entre murs et murmures, entre le solide et le souffle, entre
l'aplomb de la toile et la légèreté presque instable de ce qui s'y dépose juste
en surface : quelque chose comme l'invention, la ré-invention plutôt, par
l'effet du hasard et du fantasme, de la nature du mur. Mur imaginé. Mur
imaginaire. Mur flottant. Mur virtuel. Mur rêvé. Mur suggéré. Mur chuchotté.
Mur… Mur… Murmure…On y revient, et l'on se rend compte face à ces toiles que le
mur est un concept plus riche encore que ce que l'on pouvait soupçonner…
Il y a là, dans cette rencontre d'une matière ressuscitée, d'une
peinture ayant eu déjà une vie antérieure sur d'autres tableaux, et d'une
surface vierge afin de donner vie à de nouvelles œuvres, une forme
d'aboutissement de la démarche de Pascale Morelot-Palu dont on devine déjà à
quel point il s'annonce fécond. Un
souffle de mur est la conséquence de son acharnement, dans ses séries
antérieures, à déconstruire (en grattant les épaisseurs de peinture accumulées,
pour faire surgir des couleurs et des formes) et à reconstruire (en ajoutant
une figure ou une tache) pour mieux mettre en exergue. Non plus désormais l'archéologie
de ces murs recréés qu'elle mettait à nu à force de dépouillement de leurs
strates successives. Non plus la charge de passé, le poids d'histoires
anciennes qu'ils portaient. Non plus la volonté de souligner d'un trait, d'une
marque, d'une esquisse, le rôle ou la fonction de ces murs. Non. Ici, les
couleurs et les coulures, les masses et les vides, les gestes longs et les
zébrures, la puissance imposante des noirs et l'élégance inouïe de certains
encéphalogrammes ou de divers cernes d'arbres fusant d'on ne sait où, imposent
seuls la réalité, ou l'irréalité c'est selon, des tableaux, et donc des murs
qui s'imaginent sur la toile.
Murs sauvages, murs révélés, c'était hier même si cela doit se
poursuivre encore et encore parce que le processus créatif que Pascale
Morelot-Palu a généré ne s'épuise jamais, et que son art se nourrit d'une
production à l'énergie inusable, jamais rassasiée d'elle-même. Mais
aujourd'hui, d'un geste sauvage, presque inconsidéré, ce sont des murs surgis
de nulle part qu'elle révèle. Souffles de murs puisqu'il en est ainsi. Et c'est
pareil et infiniment différent. Pareil parce qu'on reconnaît sans l'ombre d'un
doute la manière de faire de l'artiste. Et différent parce qu'il y a, dans
cette série, une forme de mélancolie douce, de présence-absence, de mystère
merveilleusement impalpable, qui ne se soupçonnaient guère jusqu'alors, comme
si ce Souffle de mur, ce singulier
murmure, était un secret que Pascale Morelot-Palu acceptait enfin de dévoiler…
Galerie Burdeau, 28 rue Burdeau, Lyon, à partir du 5 septembre.
Inscription à :
Commentaires (Atom)